
I) Finesse et universalité
Sur Terre, à échelle humaine, l'idée d'universalité du temps peut surprendre: en effet, l'heure solaire perçue par un individu varie selon sa localisation sur le globe. Par exemple, il fait nuit noire à Paris quand le soleil se lève sur Beijing et qu'il se couche sur New-York.
C'est pourquoi le système des fuseaux horaires a été instauré dès 1884, lors de la conférence internationale de Washington, qui définit 24 divisions du globe, suivant globalemnt le tracé des méridiens, prenant celui de Greenwich comme référence, ou "méridien zéro".
Ainsi, chaque état dispose d'une heure cohérente avec son cycle nycthéméral ("jour/nuit"), et uniforme sur son territoire (sauf dans le cas de pays de grande étendue longitudinale, comme la Russie).
Cette solution répondait à des besoins concrets, exprimés notamment avec le développement des communications et des transports suite à la révolution industrielle, tels que la concordance des horaires de train.
Aujourd'hui, ce système est toujours en vigueur, et son utilisation trouve des applications internationales.
Cependant, les échanges informatiques se sont développés à tous les niveaux pour prendre une place prépondérante dans la mondialisation. Leur vitesse est telle qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer l'instant démission d'un signal de celui de sa récéption. En d'autres termes, il est désormais possible de communiquer avec une quasi simultanéité.
La mise en place d'une échelle de temps absolue est donc nécessaire pour permettre la cohérence et la coordination des échanges mondiaux.


Cette échelle de temps, aujourd'hui adoptée par la plupart des pays, est le Temps Unviversel Coordonné, abrégé en UTC (compromis entre le français et l'anglais) et, comme toute échelle de temps, son origine est intrinsèquement liée à la mesure du temps.
Exemple:
La problématique
-
Un avion décolle de New-York à 20h00 heure locale pour un vol d’une durée de 7 heures qui le conduit à Paris.
-
Questions :
-
A quelle heure locale va-t-il atterrir à paris ?
-
Quelle heure sera-t-il alors à New-York ?
-
Échelle de temps
Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est une échelle de temps.
Échelle de temps: Système de repérage des événements, constitué par une origine et une unité de temps, ou d'une façon plus générale par une séquence numérotée d'intervalles non nécessairement égaux.
Dans toutes nos échelles modernes (UT, TAI, UTC), l'unité de temps est la seconde.
UT ( de l'anglais United Time)
Le temps universel est une échelle de temps fondée sur l'observation de corps célestes, dont la périodicité permet de mesurer la durée d'une rotation terrestre.
En d'autres termes, on observe des objets célestes afin de déterminer la durée d'une rotation terrestre (un objet revient au point initial d'observation après une rotation complète de la Terre sur elle-même). Les objets lointains sont privilégiés, puisqu'ils donnent une précision accrue à la mesure.
De cette durée, on peut déterminer la durée d'une seconde, que l'on a arbitrairement définie comme étant 1/86 400 d'un jour solaire.
Malgré le gain de précision qui accompagne l'observation de corps de plus en plus lointains, ce procédé présente un problème majeur : la rotation de la Terre sur laquelle il se base est irrégulière. En effet, à cause de divers phénomènes tels que les marées, tremblements de terre, la force de gravitation exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre, le temps nécessaire à une rotation complète de la Terre sur elle-même fluctue. La rotation terrestre ralentit, entraînant l'allongement de la journée et donc, de la seconde.
Pour pallier à ce problème, la communauté scientifique s'est accordée sur la création d'une nouvelle échelle de temps, fondée sur une nouvelle définition de la seconde : le temps atomique.
TAI (du français Temps Atomique International):
En 1966, une nouvelle définition de l'unité de temps est adoptée, pour parer le décalage du temps UT.
Unité de temps : Période d'une certaine vibration dans un atome, de façon à ne plus dépendre d'aucun objet.
Dès 1967, l'échelle de temps universelle est le TAI. Le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) définit la seconde de cette manière :
« La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. »
Pour expliquer ce résultat, il faut exploiter les formules de transition atomique.
Lorsqu'un atome passe d'un état excité E2 à un état d'énergie moins excité E1, il émet la plupart du temps un photon. Il nécessite à l'inverse un photon pour passer d'un état E1 à un état E2 plus excité. Dans les deux cas, le photon a une fréquence ν telle que:
ν la fréquence du photon en s (Hertz)
ΔE l'énergie en J
h la constante de Planck, égale à 6,63.10 J.s
Pour l'atome de césium 133: ν = 9 192 631 770 Hz
De cette manière, on obtient une échelle de temps plus précise qui ne dépend d'aucun élément extérieur. Cela est rendu possible grâce aux horloges atomiques qui sont d'une précision telle que les plus performantes actuellement ne dérive que d'une seconde tous les 3 milliards d'années (et la plupart des autres dérive d'une seconde tous les 150 millions d'années environ).
Le TAI est défini à l'aide de près de 400 de ces horloges (dont 25 en France), réparties dans différents laboratoires autour du globe.
Cependant, cette nouvelle échelle de temps ne tient plus compte de la journée observable à l'échelle humaine ; elle s'en décale. C'est pourquoi il est nécessaire de coordonner TAI et UT, chose faite avec la création d'une troisième échelle de temps tenant compte des deux précédentes : Le temps UTC.
UTC (pour United Time Coordinated, un compromis entre CUT et TUC, les sigles respectifs anglais et français)
Le temps universel coordonné est une échelle de temps qui se base sur le Temps Atomique International, lui empruntant sa stabilité, tout en restant proche du Temps Universel, pour rester au plus proche du jour solaire. L'unité de temps, toujours la seconde, a donc exactement la même définition que pour le TAI. En revanche, contrairement à ce dernier, le temps UTC doit toujours être à moins d'une seconde de décalage avec le Temps Universel, selon un accord international datant de 1972.
On a :
Pour compenser cette avance sur UT, des « secondes intercalaires » sont instaurées. Ainsi, souvent en décembre ou en juin, il arrive qu'une heure soit composée de 3601 secondes, contre 3600 d'ordinaire. La dernière en date a été introduite dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2015 ; c'est la vingt-sixième depuis l'instauration du système (1972). La décision d'ajouter une telle seconde doit être prise au niveau international : c'est une des prérogatives de la composante « Service de la Rotation de la Terre » de l'IERS (de l'anglais International Earth Rotation and Reference System Service), implantée à l’Observatoire de Paris au sein du département SYRTE (Observatoire de Paris / CNRS / UPMC / LNE).
Selon un récent bulletin de ce service, il n'y aura pas de seconde intercalaire introduite en juin 2016.

-1
-34

Sur ce graphique, nous pouvons clairement voir le décalage progressif qui existe entre les deux échelles. Chaque brusque variation entre deux pics correspond à l'introduction d'une seconde intercalaire, qui comble l'avance prise naturellement par UTC sur UT.
De ce fait, malgré leur unité commune de temps, il existe également un décalage croissant entre UTC et TAI, mais qui reste toujours d'un nombre entier de secondes.
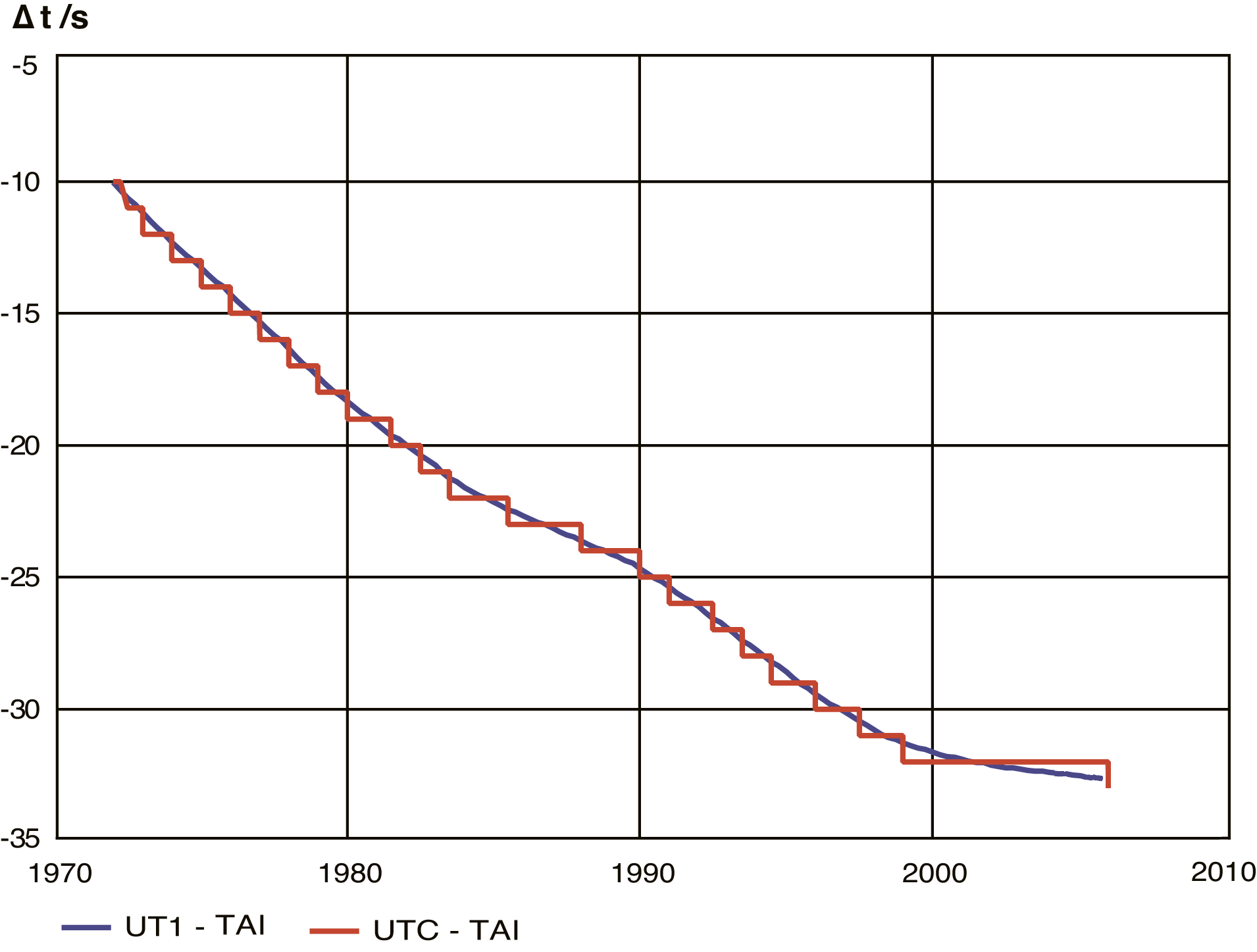
Conclusion:
Pour répondre à ses besoins, l'Homme s'est trouvé face à un défi social, mathématique et physique : accorder le monde sur une échelle de temps. L'unité, la seconde, devait être invariable, quelle que soit notre localisation ou notre culture, c'est pourquoi nous nous sommes basés sur les propriétés immuables de l'atome pour sa définition, dont la précision est permise par la finesse toujours croissante des instruments de mesure actuels, les horloges atomiques. Les applications sont diverses, notamment dans une époque où l'homme est à la fois tourné vers son monde, l'infiniment grand et l'infiniment petit.